Hier, la revue pour enseignants « les cahiers pédagogiques » fêtait son 500ème numéro en organisant deux tables rondes sur des sujets en rapport avec les médias et le numérique. Les sujets m’intéressant beaucoup, de même que les gens gravitant autour du journal, je suis donc allé profiter des confortables fauteuils en ouvrant grands les oreilles.
Un peu de contexte, avant toute chose. La revue a démarré en 1945 à l’époque du plan Langevin-Wallon comme un bulletin de liaison entre enseignants. Si la formule a changé, la philosophie générale reste la même 65 ans après. Elle a la particularité d’ouvrir ses colonnes à tous les enseignants qui souhaitent écrire dedans et d’avoir un positionnement « politique », au sens large du terme, que je qualifierai de social-démocrate, ou, en tout cas, pas trop radical. Le but (implicite?) est de changer les pratiques, voire plus, par l’exemple. Dit autrement, de tenter de changer la société en montrant que, dans les classes, il y a des choses qui fonctionnent et qui gagneraient à être partagées par tous. Le ton se veut pragmatique et dégagé de tout discours idéologique.
Autant le dire tout de suite, si la revue est un des nœud du réseau (surnommé par d’autres) « pédagogistes », c’est à dire de ceux qui pensent que la manière d’organiser la classe et les enseignements a une importance essentielle dans la réussite des élèves, elle n’est pas si connue que cela en dehors d’un milieu diffus de « militants pédagogiques ». J’ai l’impression, notamment, qu’elle est plus lue dans le secondaire que dans le primaire.
Un petit aparté, avant de continuer, néanmoins: il aura beaucoup été question, pendant cette journée, de la bagarre idéologique entre « républicains » et « pédagogistes ». J’aimerai éviter de perdre tout le monde avec ça, d’autant que c’est assez nébuleux et qu’expliquer en quoi elle consiste prendrait des pages, si tant est qu’elle existe ailleurs que dans les esprits. Il faut en dire quelques lignes, malheureusement. Il s’agit d’un conflit virulent entre deux grandes manières de concevoir l’éducation. Le champ de bataille, beaucoup plus que dans les classes, se situe essentiellement dans les médias et les rayons des librairies (assez peu dans les ministères, par contre). Elle oppose, avec d’infinies nuances et de nombreuses variantes depuis un bon siècle, les progressistes et les conservateurs, ceux qui veulent une école pour tous et ceux qui veulent une école d’élite, les partisans des bonnes-vieilles-méthodes-qui-marchent et ceux qui cherchent à faire mieux, les instituteurs et les profs du secondaire, la gauche et la droite, etc… Ce « etc… » résume toute l’ambiguïté du sujet, parce qu’au final, personne d’un peu honnête n’en sait vraiment rien, surtout quand on s’aperçoit que les différences dans la manière de faire classe sont plutôt minces.
D’autant qu’il vaut mieux avoir deux camps, quand il y a bagarre. Ici, les « républicains » sont un peu seuls sur le champ de bataille, parce que les « pédagogistes » ont autre chose à faire que de répondre aux braillements et à la malhonnêteté d’en face. Si vous voulez vous faire une idée, faites un tour sur le blog du Eric Zemmour de l’éducation.
Ca se passait donc dans les locaux de la MGEN, pas loin de Montparnasse, dans une belle et grande salle, équipée d’un matériel impressionnant: vidéoprojecteur de compétition, caméra rotative pour faire de beaux plans de la salle, sono aux petits oignons, etc… Pas de doute, ça en jette. Si j’étais de mauvaise foi, je pourrai tiquer sur l’utilisation de l’argent que j’ai versé à la MGEN pendant des années et dont je n’ai pas vraiment revu la couleur quand il a fallu payer mon dentiste…
9h30-10h00
Après l’inévitable café, dont le , reste de permettre à chacun de discuter, revoir les amis ou mettre des visages sur des gens croisés uniquement sur le net, ça commence avec une série de discours.
10h00 – Les discours
Autour de 170 personnes, avec pas mal de personnes à responsabilités et/ou connues. En vrac, en plus de ceux présents aux tribunes: Claude Lelièvre, historien médiatique de l’éducation, Sylvain Connac, prof des écoles qui écrit des bouquins géniaux, et membre éminent de mon panthéon professionnel, Bernard Defrance, philosophe, Louise Tourret, productrice sur France Culture ou Jean Jacques Hazan, président de la FCPE. Le public est socialement assez homogène à première vue (assez mixte, moyenne d’âge élevée, absolument pas coloré). Ca donne une bonne indication du .
Arrivée du ministre, suivi par quelques types faisant furieusement penser à des gardes du corps (à moins que ce ne soit que des participants endimanchés ?). Les trois discours s’enchainent heureusement assez vite. Passons rapidement sur le premier, par le secrétaire général de la MGEN, mais assez peu intéressant sur le fond.
 Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale
Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale
Passons à peine plus lentement sur celui de Vincent Peillon, venu vendre sa loi d’orientation et de programmation et montrer à quel point il y a des convergences entre l’action des cahiers pédagogiques et celle qu’il veut impulser. Pas d’annonce particulière, pas un mot plus haut que l’autre, à part une petite soufflette discrète sur les « républicains ». Rien de révolutionnaire, mais ça fait du bien à entendre. Il a d’ailleurs été longuement applaudi (un peu trop à mon goût, vu ce qu’il a dit, mais après 5 ans de maltraitance, je peux comprendre).
Phillipe Watrelot, pas sous son meilleur profil (toutes mes confuses)
, enfin, qui finit par un brin d’histoire du journal et de contexte. Intéressant, quelques traits d’humour. Egal à ce qu’on peut lire de lui sur internet, finalement.
A noter, quand même, la fierté d’avoir un ministre à la tribune était quelque chose de prégnant dans son discours. La reconnaissance de l’institution est toujours un moteur aussi important chez les profs, visiblement…
10h30 – Comment la pédagogie (et l’école, par extension), sont traités dans les médias traditionnels ?
La tribune réunissait un panel de gens intéressants. Une journaliste à l’express.fr (et ex de l’AEF, l’agence de presse spécialisé sur l’éducation), ici en qualité de présidente de l’association des journalistes spécialisés sur le sujet, un enseignant qui prépare une thèse sur les relations médias-école depuis 1959 (si cette dernière est au niveau de son discours, elle promet d’être passionnante…), un historien de l’éducation (autre que Claude Lelièvre ou Antoine Prost, ça change) un peu en dessous, en terme de qualité, peut-être parce que moins rodé à l’exercice. Une chercheuse et directrice de collection belge, qui a travaillé à l’OCDE (avec un discours un peu critique sur PISA, merci), bien péchue.
 Yann Forestier, enseignant d’histoire géo, spécialiste des médias, Gaetane Chapelle, Chercheuse et directrice de collection, Phillipe Watrelot, CRAP-Cahiers pédas, François Jacquet-Francillon, historien de l’éducation, Marie-Caroline Missir, L’express.fr
Yann Forestier, enseignant d’histoire géo, spécialiste des médias, Gaetane Chapelle, Chercheuse et directrice de collection, Phillipe Watrelot, CRAP-Cahiers pédas, François Jacquet-Francillon, historien de l’éducation, Marie-Caroline Missir, L’express.fr
En fond, les dessins live, de Jack Koch
Sans rentrer dans le détail de cette passionnante heure et demie, un résumé de ce qui en est sorti s’impose.
Il y a consensus pour dire que les médias généralistes s’intéressent peu et mal à l’éducation, et encore moins à la pédagogie, même si c’est en train de changer depuis une poignée d’années. A noter qu’on a peu parlé de la télévision et de la radio, la discussion étant restée centrée sur la presse écrite.
Les raisons semblent être liées non pas aux journalistes spécialisés qui font leur boulot correctement dans le cadre qui leur est imposé (qui est contraignant, effectivement), mais plutôt à des raisons larges: tendance au traitement binaire d’un phénomène, pas assez de reportages, demandes des rédac’ chefs, trop de place laissée aux commentaires et pas assez à la présentation des faits, .
La ou les solution(s) semblent être, de manière très peu surprenante, vers un retour aux faits et au terrain. Aux fondamentaux de la presse, en bref, comme aller voir les gens dans leur établissement, faire des enquêtes, des reportages, etc… Bref, la base.
Une petit pique, en passant et encore, pour Marie-Caroline Missir, qui n’a pas pu s’empêcher de sortir le laïus habituel dès qu’on critique la presse. Question à la salle: « Combien d’entre vous sont venus avec un journal sous le bras ? ». Raté, une bonne moitié de la salle, à vue de nez. Le discours sur le thème « C’est la faute à Internet si la presse va mal » faisait aussi un peu de peine à entendre.
14h00 – Du théâtre interactif
L’après-midi, ça commence avec un OSNI (objet scénique non identifié): un théâtre-forum. Quatre saynètes autour de l’école, jouées deux fois, la première sans interruption, la deuxième, avec possibilité pour le public d’interrompre les acteurs et de venir proposer une autre résolution de la situation, en impro. Après chaque intervention, un résumé, en une image figée. C’était vraiment très très drôle, tout en oubliant d’être bête. Le dispositif est vraiment à diffuser…
Pour info: la compagnie s’appelle « entrées de jeu » (site web ici) et on a eu droit à « pas de fausses notes pour les feuilles doubles » (avec un modification sur la quatrième scène) à trouver sur leur site, dans la rubrique « évaluation ».
 4 profs, 4 stylos rouges, des dizaines de copies…
4 profs, 4 stylos rouges, des dizaines de copies…
 …et au milieu, celle de Simon, 5ème B, pas simple à noter… (la photo est peu lisible, mes confuses)
…et au milieu, celle de Simon, 5ème B, pas simple à noter… (la photo est peu lisible, mes confuses)
 …Hop…Interruption, Bernard Defrance à la manœuvre, au milieu du chahut, en train de valoriser le texte à haute voix.
…Hop…Interruption, Bernard Defrance à la manœuvre, au milieu du chahut, en train de valoriser le texte à haute voix.
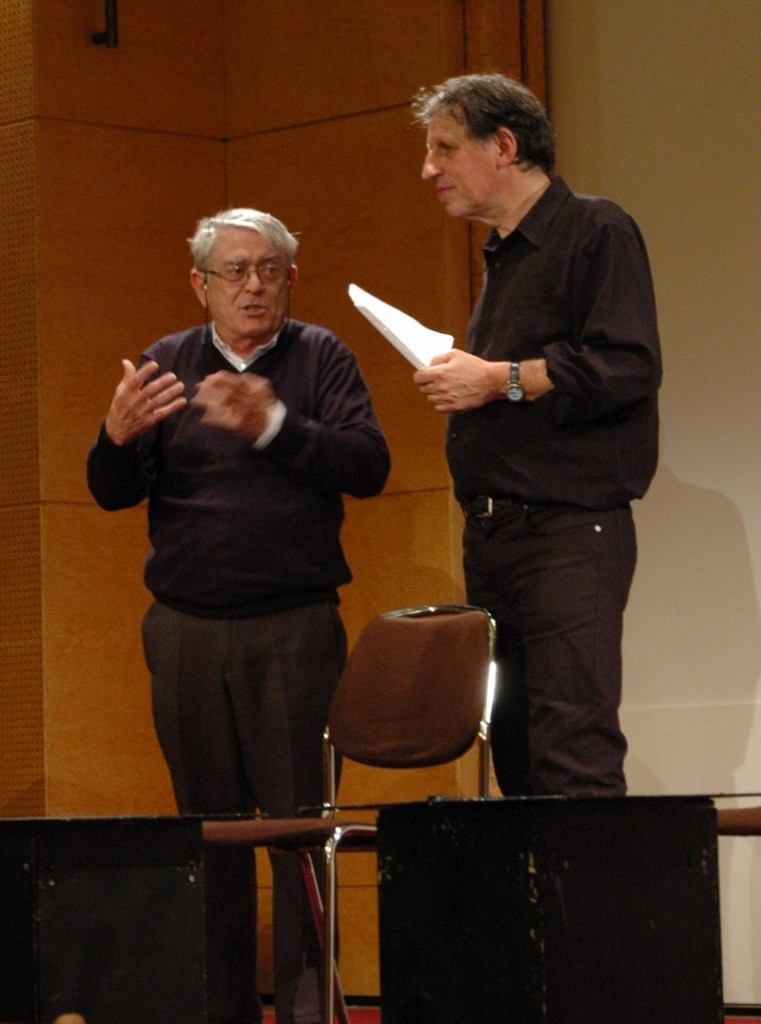 Debriefing dans la foulée: « La note, on s’en fout… Soit c’est parfait et on peut publier, soit on retravaille. » (de mémoire, mais c’était proche)
Debriefing dans la foulée: « La note, on s’en fout… Soit c’est parfait et on peut publier, soit on retravaille. » (de mémoire, mais c’était proche)
 Bilan de l’intervention, en une image (l’enfant-roi :)
Bilan de l’intervention, en une image (l’enfant-roi :)
 Deuxième situation: « Monsieur, j’ai oublié mon devoir chez moi.
Deuxième situation: « Monsieur, j’ai oublié mon devoir chez moi.
– Bon, tu viendras me voir après le cours. »
 Autre résolution: « C’est pas grave, tu vas le faire maintenant au fond de la classe.
Autre résolution: « C’est pas grave, tu vas le faire maintenant au fond de la classe.
-Mais euh… »
 Troisième situation: la remise des copies, certains sont contents de leur note, d’autres beaucoup plus énervés…
Troisième situation: la remise des copies, certains sont contents de leur note, d’autres beaucoup plus énervés…
 Après une intervention, la classe bascule en mode zen
Après une intervention, la classe bascule en mode zen
 Dernière situation: « Mon fils est dyslexique, il lui faut un régime de faveur et vous lui avez mis -4 à sa dernière rédaction…
Dernière situation: « Mon fils est dyslexique, il lui faut un régime de faveur et vous lui avez mis -4 à sa dernière rédaction…
-Bon, écoutez, on va travailler ensemble pour l’aider. »
 Le responsable de la troupe et les comédiens, tous vraiment, mais vraiment drôles… beaucoup plus que je ne saurais le rendre en photo.
Le responsable de la troupe et les comédiens, tous vraiment, mais vraiment drôles… beaucoup plus que je ne saurais le rendre en photo.
16h00 – Innovation pédagogique et circulation des idées
Les intervenants, d’abord.
 Stéphanie de Vanssay, enseignante et syndicaliste (SE-UNSA), Luc Cédelle, journaliste spécialisé et blogueur (Le monde), Christine Vallin, CRAP-Cahiers Pédas, Serge Pouts-Lajus, enseignant spécialisé dans les TICE, Patrice Bride, rédacteur en chef des cahiers pédas.
Stéphanie de Vanssay, enseignante et syndicaliste (SE-UNSA), Luc Cédelle, journaliste spécialisé et blogueur (Le monde), Christine Vallin, CRAP-Cahiers Pédas, Serge Pouts-Lajus, enseignant spécialisé dans les TICE, Patrice Bride, rédacteur en chef des cahiers pédas.
L’intitulé précis de la table ronde était « Quelle rôle jouent les réseaux sociaux, les forums, les listes de diffusion dans la diffusion des innovations et de la réflexion pédagogique ? » Assez vite, quelque soit l’intervenant (avec, des nuances, bien sûr), la discussion s’est focalisée sur Twitter.
Chose remarquable, j’ai très peu entendu de critiques sur l’utilisation du microblog, une question sur le sujet est même passée à la trappe sans relance de l’intervenante. Si Luc Cédelle et Serge Pouts-Lajus ont bien mis quelques légers bémols, je garde l’impression tenace d’avoir eu un mélange de et de « fétichisme de la marchandise », pour reprendre Marx (c’est nouveau, c’est innovant, donc on peut s’y lancer sans réflexion de fond). Un peu comme si les innovateurs pédagogiques s’étaient emparés de cet espace en espérant faire bouger les lignes, puisqu’ils n’y ont pas réussi autant qu’espéré en bataillant ailleurs.
J’ai trouvé très intéressant, néanmoins, que Serge Pouts-Lajus témoigne qu’en une dizaine d’années d’investissement des nouvelles technologies par les innovateurs pédagogiques pour faire circuler les trucs qui marchent, c’est plutôt moins réussi qu’attendu. Un semi-constat d’échec, finalement.
Un peu plus loin dans la discussion, il rappelle que pour faire vraiment changer les choses, il faut bosser à l’échelle d’un établissement, avec des collègues présents physiquement autour de soi. J’y vois un écho très net avec les discours sur les liens faibles et les liens forts dans l’action de transformation sociale (voir ce très intéressant article, en particulier). On est meilleur pour changer l’école (et la société) si on se regroupe et qu’on bosse au même endroit…
Une petite chose agaçante, néanmoins, était la manière de gérer les interventions de la salle. Il fallait écrire ça sur un petit bout de papier qui sera lu à la tribune. J’en garde la sensation désagréable de dépersonnalisation du débat.
Bref, un table ronde pas inintéressante, même si j’ai souvent été gêné aux entournures par le côté un peu techno-béat des discours.
Un bilan ?
Une bonne journée, au final. Des invités globalement intéressants, de la bienveillance dans les discours, l’envie de continuer à essayer de changer les choses, de l’intelligence collective, ça fait un mélange riche.
Reste une question, tout de même: pourquoi ça ne suffit pas ? Pourquoi l’école et la société ne change-t-elle que trop peu ? Vaste sujet, évidemment, mais une piste solide tient sans doute au fait que les animateurs et participants aux cahiers péda sont trop gentils. Comment se fait-il qu’il n’y a eu personne pour claquer le bec efficacement à Milner, Finkelkraut, Brighelli et autres pénibles « républicains » pendant si longtemps ? Pourquoi le seul qui s’y colle (et encore, un peu mollement, je trouve), c’est Meirieu ? Où est la part de combativité médiatique pour faire activement de la place à ces idées justes et émancipatrices, nom de Zeus ?
Je rêve encore d’un débat télévisé où un « pédagogiste » mouchera Brigellhi intelligemment. Un jour, qui sait ?
Pour compléter, trois autres compte-rendus, ailleurs sur le net:
- Chez le secrétaire général à la pédagogie du SNALC (SNALC, pédagogie, oui, je sais, ça fait bizarre…).
- Sur le forum néos-profs.
- Sur le site ds cahiers pédas.

